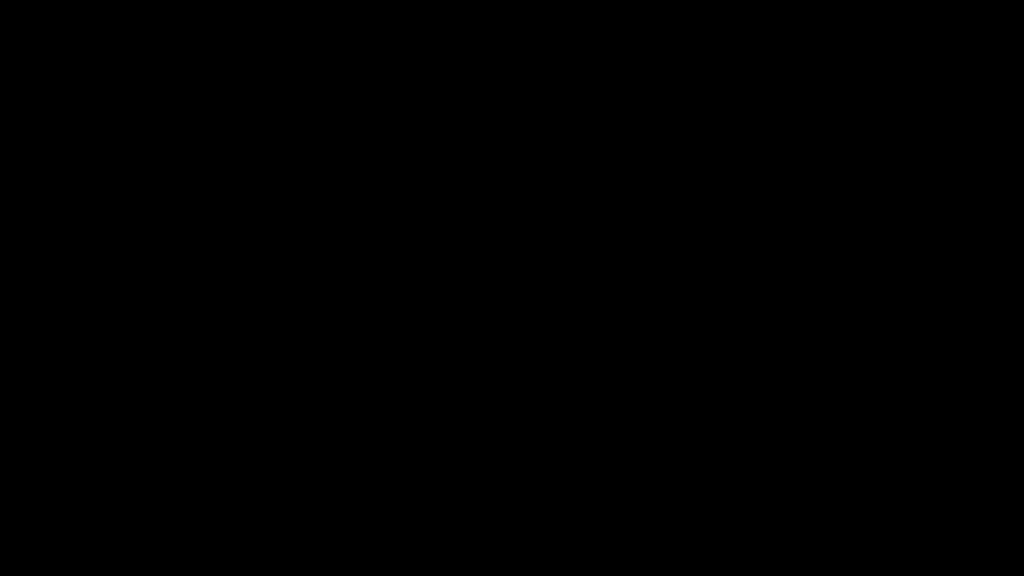
« Tu n’as rien vu à Hiroshima. Rien. »
La réplique est obstinément répétée par Eiji Okada dans Hiroshima, mon amour. Emmanuelle Riva objecte : « Les reconstitutions ont été faites le plus sérieusement possible. Les films ont été faits le plus sérieusement possible. L’illusion, c’est bien simple, est tellement parfaite que les touristes pleurent », et la caméra documentaire de Resnais glisse le long des vitrines du musée et montre des images des films « sérieusement faits ». Les mots de Duras tombent : « Tu n’as rien vu. Rien ».
Non, on n’a rien vu.
Non,
Et pourtant, on a quand même vu quelque chose. Et surtout grâce au cinéma, y compris celui d’Alain Resnais et de Marguerite Duras. Quand on cherche à se représenter la guerre, c’est souvent une séquence ou un plan de cinéma qui ressurgit, et souvent venus d’un film de fiction. Celle-ci a pour elle la médiation possible de la mise en scène, du jeu d’acteur, de la fable. Mais qu’en est-il du cinéma documentaire ?
Quand le réel est la matière première du film, que peut-on voir d’une réalité insoutenable au regard ? À plus forte raison, quand le film est contemporain d’un conflit, qu’il se tourne parmi les morts et les larmes, le feu et le fer, avant même son issue, avant que ne survienne la tentation d’en raisonner a posteriori les récits et la mémoire.
Cet état d’incertitude (sera-t-on victorieux ou vaincu ?) et d’urgence (filmer pour témoigner, filmer pour « vivre libre ») des films pris dans la guerre serait-il porteur d’une qualité particulière qui modèle le cinéma autant que celui-ci, en retour, invente la guerre, ou, du moins, sa représentation ?
Pour percevoir au mieux ce cinéma à l’épreuve du feu, nous montrerons des films peu vus, encore peu commentés, afin de préserver une expérience de spectateur aussi intacte que possible.
Peu vus, parce que rares, comme Histoire de la guerre civile (1921) de Dziga Vertov, film invisible pendant cent ans, récemment restauré, et montré une seule fois en France. Nikolaï Izvolov, qui a mené durant deux années le travail de reconstitution, apportera son éclairage sur la fabrication de ce film. Œuvre étonnante, faite d’images récupérées aussi bien que filmées par les opérateurs de Vertov, à la fois personnelle et anonyme, elle est aussi un document inouï sur la guerre civile russe que le réalisateur a suivie à bord des trains blindés de l’Armée rouge.
Peu vus, parce que négligés en France, comme les extraordinaires films de Humphrey Jennings dont nous verrons The Silent Village (1943), évocation de l’assassinat de Heydrich, transposé dans un village minier du Pays de Galles.
Peu vus, enfin, parce qu’ayant fait leurs premières en festivals au cours de l’année 2024 et quasiment inédits en France. Venus d’Arménie, de Palestine, de Russie, d’Ukraine et réalisés par des cinéastes d’expériences et de styles très différents, unis pourtant par une même nécessité de filmer une guerre, la leur, qui en devient la nôtre. Alors, peut-être, pourrons-nous en voir quelque chose.
« Sur cette Terre, il y a quelque chose d’effroyable, c’est que tout le monde a ses raisons. »
La célèbre réplique d’Octave dans La Règle du jeu de Jean Renoir, film crépusculaire où les squelettes dansent au bord du gouffre de 1939, pourrait servir de devise au héros moderne, jeté au monde, privé de sens.
Pourtant, dans le cinéma de fiction, cet art du XIXe siècle comme disait Godard, le héros a su résister avec une vitalité intacte, si ce n’est décuplée, jusqu’à nos jours.
Le cinéma documentaire et, en particulier, celui tourné pendant les guerres semble, lui, s’être inventé d’autres incarnations. Le réel finit toujours par y déborder à un endroit ou à un autre et à reprendre la main. Les chefs de l’Armée rouge vertoviens sont hirsutes, souriants et en haillons, futurs ennemis du peuple pour beaucoup d’entre eux, bien éloignés de l’iconographie héroïque soviétique. Les mineurs gallois qui jouent à interpréter ceux de Lidice, racontent modestement leur communauté par les gestes du travail, la « cup of tea », ou la réunion au pub. C’est en cela qu’ils deviennent partisans tchèques et universels. Le cinéma documentaire en guerre, laissant de côté le héros unique, fait place à un « nous » qui, de film en film, semble traverser le temps, et révèle les destinées anonymes, finalement si semblables, d’un pays et d’une époque à l’autre, emportées dans le tourbillon de l’Histoire.
Comme chez Renoir, c’est la Danse macabre de Camille Saint-Saëns qui résonne sur les images de propagande de l’armée israélienne, utilisées par Kamal Aljafari dans Paradiso, XXXI, 108 (2022). Il y détourne les films de l’ennemi pour mieux montrer l’invisibilisation du peuple palestinien, véritable héros absent de ces déserts dédiés aux manœuvres militaires. Et c’est encore ce peuple qui illumine les archives palestiniennes utilisées dans A Fidai Film (2024), images volées par l’armée israélienne, puis récupérées par le réalisateur qui y déploie son langage plastique, rageur et poétique, en en faisant littéralement un « film guerrier », a fidai film, intime et collectif.
Silva Khnkanosian et son Far from Michigan (2023) dessine le portrait choral d’un autre peuple menacé de disparition en filmant les Arméniens du Haut-Karabagh. Sa caméra bouge, sa caméra a peur, sa caméra partage, jour après jour, les abris antiaériens et la fuite le long des routes. Les mots laconiques de son journal de bord apparaissent de temps à autre incrustés à l’image, renforçant l’impression d’un temps immobile, figé dans la peur qu’un geste de trop fasse basculer dans la défaite cette petite enclave arménienne en territoire azerbaïdjanais, ici révélée dans toute sa précarité.
Dans le film d’Alexander Kuznetsov, on a d’abord l’impression de retrouver des héroïnes classiques, Yulia et Katia, jeunes femmes russes déjà rencontrées dans deux opus précédents du réalisateur, Territoire de l’amour (2010) et surtout Manuel de libération (2016), où elles tentaient de sortir de l’hôpital psychiatrique où elles étaient abusivement internées. Dans Une vie ordinaire (2023), les voilà libres et face à une nouvelle vie à construire. Mais, le 24 février 2022, la Russie envahit l’Ukraine. Le film vacille, la chronique se craquelle. Les deux héroïnes sont avalées par l’ogre de la guerre qui emporte aussi le réalisateur, qui choisit de laisser dériver son film devant un monde aussi déraisonnable. Yulia et Katia n’aspiraient qu’à la « normalité », mais que faire quand celle-ci a basculé dans la démence d’un pays entier ?
De l’autre côté du front, Sergei Loznitsa parcourt l’Ukraine, d’une région et d’une saison à l’autre, relevant les blessures et les traumatismes du conflit dans la vie quotidienne de ses habitants.
On retrouve dans L’Invasion (2024), les traits stylistiques du cinéaste : plans fixes attentifs, sons reconstruits, sens suspendu. Mais ici il recompose une fresque à la complexité entêtante, rétive à toute récupération, filmant la guerre quand elle envahit chaque partie de la vie, fléau insensé aux effets imprévisibles et morbides.
« La guerre c’est simple, c’est faire entrer un morceau de fer dans un morceau de chair. »
… entend-on au début de For Ever Mozart de Jean-Luc Godard. Et le cinéaste y fait de Sarajevo le théâtre dissonant d’une guerre qui y résonne encore. Mais filmer le morceau de fer et le morceau de chair dans le réel, c’est moins « simple ». Chacun des films de notre séminaire s’y confronte à sa façon.
Pour faire le lien entre les films d’hier et ceux d’aujourd’hui, nous serons accompagnés par le critique et historien du cinéma Federico Rossin. Avec lui, nous discuterons de Vertov et de Jennings, mais aussi d’autres cinéastes, à travers des extraits de leurs films qu’il nous fera découvrir, commentant, contredisant, déconstruisant, et mettant en relation diverses époques, créant des ponts inattendus, à même, peut-être, de dépasser cette aporie entre l’irreprésentable des guerres réelles (le fer dans la chair) et la nécessité de les mettre en images et en sons, pour qu’elles existent, pour qu’elles ne sombrent pas dans l’oubli, ou l’aveuglement de l’habitude.
Pour ce qui est des films récents, nous aurons la chance de pouvoir échanger avec les cinéastes présents et de les interroger sur la façon dont eux-mêmes ont traversé cette expérience. Comment ont-ils choisi de raconter, de témoigner, de faire film, en dépit des difficultés intimes et formelles ?
Il s’agit souvent d’œuvres particulièrement personnelles et intuitives, avançant à découvert, débordées par un objet qui prolifère, saisissant un ici et maintenant fragmentaire, mouvant, ignorant de l’avenir. Et c’est peut-être cette précarité constitutive qui leur donne une acuité extrême à s’attacher aux visages, aux regards, aux corps, aux paysages, aux détails, parfois minuscules, dont on sent qu’il faut les relever avec soin, comme les pièces à conviction d’un procès à venir, celui de l’Histoire. C’est sans doute aussi ce qui rend ces films si bouleversants.
Vladimir Léon
Coordination : Vladimir Léon.
Avec Kamal Aljafari, Nikolaï Izvolov (en visio), Silva Khnkanosian, Alexander Kuznetsov, Sergei Loznitsa (sous réserve), Federico Rossin.
Le séminaire est précédé par une séance spéciale préambule, avec Silence of Reason de Kumjana Novakova (mercredi 21.08, 21:00, Salle des fêtes) et prolongé par une séance de Expériences du regard avec Interceptés de Oksana Karpovych (samedi 24.08, 10:15, Salle Scam).
Ardèche images
L’Imaginaire · 300 route de Mirabel
07170 · Lussas – France
+33 (0) 475 942 806
SIRET : 319 098 216 00058 • APE : 9499Z
TVA : FR11319098216